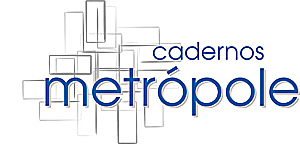Abstracts
A partir da indagação sobre o que se pode entender por cidade neoliberal na América Latina nos anos 1990, o artigo apresenta algumas reflexões sobre eventos que pontuaram a história das cidades, identificando quais são as categorias do passado que esclarecem as atualmente em uso nas investigações e, principalmente, as referentes aos sistemas que organizam um domínio particular: a metrópole na América Latina. Como em qualquer parte, a cidade neoliberal é a cidade financeirizada, onde a construção sob todas as suas formas, em todo o território urbano que faz agora parte dos ativos bancários, conduz à privatização dos antigos serviços e à difusão de novos serviços quase exclusivamente privados. Esta definição abarca praticamente todas as cidades da América Latina, grandes e médias, e até mesmo cidades tão diversas quanto São Paulo e Tegucigalpa. O texto destaca seis paradigmas de análise, orientadores de importantes trabalhos de pesquisa sobre o processo de urbanização latino-americano, permitindo analisar a simultaneidade e a similaridade desse processo em diferentes países e em diferentes períodos de tempo.
neoliberalismo; cidade latino-americana; urbanização
The paper initially asks what can be understood by neoliberal city in Latin America in the 1990s and presents some reflections on events that have marked the history of cities. It identifies the categories of the past that clarify the ones that are currently in use in investigations, mainly those referring to systems that organize a specific domain: the metropolis in Latin America. As in anywhere else, the neoliberal city is the financialized city, where construction, in all its forms, in the entire urban territory which is now part of bank assets, leads to the privatization of old services and to the diffusion of new services, which are almost exclusively private. This definition encompasses practically all the cities of Latin America, large and medium-sized, and even diverse cities like São Paulo and Tegucigalpa. The text highlights six analysis paradigms that have guided important research studies on the Latin American urbanization process, allowing to analyze the simultaneity and the similarity of this process in different countries and in different periods of time.
neoliberalism; Latin American city; urbanization
En Europe, l’existence d’un modèle de ville latino-américaine passe presque pour une évidence. Mais il inclut beaucoup de clichés qui ne sont pas valides partout. Culture et cultures politiques sont les champs qui soutiennent ce modèle, elles-mêmes construites sur l’image et la mémoire qu’ont les sociétés de leur propre dimension temporelle et sur la contemporanéité aux échelles urbaines et/ou nationales des événements qui forment “une mise au présent du passé”.
Ainsi peut-on suivre cette même grille d’analyse pour penser un modèle de la ville latino-américaine qui ne soit pas seulement réductible à la culture et au patrimoine mais aussi à l’impact de la mondialisation par le biais de l’imposition du néo-libéralisme économique.
Il semble quelquefois que l’histoire se répète. En Amérique latine, l’épuisement du modèle libéral dans les années 1930 faisait place sous l’impact de la révolution mexicaine et l’apparition des mouvements indigénistes, à un désir de restauration nationale et au retour aux racines dans le cadre d’une modernité universelle. C’est ainsi que les architectes voyaient le contexte dans lequel se construisait la ville (Rivière d’Arc et Schneier, 1993). A la ville néo-libérale qui a émergé dans les années 1990, les Etats qui cherchent à refonder leur histoire dans les années 2000, ne cherchent-ils pas aussi à donner un infléchissement plus social, plus original, plus national et latino-américain par le biais des politiques urbaines et de leurs projections ?
On peut déjà répondre à cette interrogation, non pas en disant que l’histoire se répète, mais en affirmant qu’elle est contingente sur un temps plus ou moins long. C’est pourquoi dans cet article, je ne reviendrai pas sur un passé connu, j’essayerai seulement de démêler les éléments dont l’articulation me semble composer le nouveau modèle de la ville latino-américaine tel qu’il se donne à voir en Europe en l’occurrence.
Pourquoi cet intérêt pour la notion de modèle? Sans doute parce qu’il permet d’échapper au contexte hégémonique de mondialisation pour expliquer un processus et parce que sa reconnaissance permet ensuite d’anticiper sur le futur et les possibles. On retiendra donc ici la notion de modèle au sens des économistes lorsqu’ils cherchent à savoir quels sont les éléments structurants d’un système et les causes de la reproduction ou non de ce dernier. Mais on posera l’échelle spatiale de la ville ou de la métropole comme substrat du modèle et non pas l’échelle nationale. Les relations entre ces éléments devraient permettre de comprendre l’existence de modèles similaires mais aussi les modalités de leur évolution historique propre.
Saskia Sassen croît pouvoir reconnaître un modèle universel de ville globale qui se différencierait seulement parce qu’il serait – et dans beaucoup de cas – tronqué. Ce ne serait alors rien d’autre qu’un retour à l’hégémonie exercée par quelques villes et par les réseaux de tout type qui exercent leurs pouvoirs virtuels à partir de ces villes. Pour un expert, cette démarche est peut-être satisfaisante. Pour un chercheur, elle me semble quelque peu réductrice dans la mesure où ce dernier ne peut pas échapper à la prise en compte du temps (politique, historique…) qui est une contingence des hypothèses qu’il émet. En d’autres termes, poser l’existence d’un modèle de ville latino-américaine ou européenne d’ailleurs, est peut-être dû au fait que la décennie 2000 a connu ici et là des moments politiques et économiques très différents. Au cours de la décennie 1990, celle de la libéralisation économique et politique tous azimuts, des privatisations, de l’ouverture aux échanges commerciaux, mais aussi culturels et intellectuels, les réseaux d’experts ont connu un âge d’or. Ces réseaux ont fait circuler leurs définitions des risques et leurs recettes sur tous les continents. On a alors pu dénoncer “une dépolitisation” des questions sociales et économiques, reprochant ainsi indirectement aux experts de désamorcer les contradictions non résolues, par le biais de leur seule crédibilité technique.
D’autres ont souligné la complexité et la difficulté que représente pour les populations urbaines, principales victimes de ces risques de toutes sortes, l’inflation des mesures bureaucratiques et/ou juridiques inspirées des recommandations et des recettes néo-libérales, pour y faire face. Mais on peut dire aussi qu’à l’autre extrême, le travail des chercheurs appuyé sur ces contingences du temps et de l’histoire, peut parfois apparaître comme un déni de tout impact d’une pensée ou d’une action réformatrice quelle qu’elle soit.
Dans ce contexte des années 1990 et 2000, qu’a-t-on alors appelé la ville néo-libérale en Amérique latine? Comme partout, mais peut-être plus encore qu’autre part, c’est la ville financiarisée où la construction sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire urbain, fait désormais partie des actifs bancaires, entraînant à son tour la privatisation des anciens services et la diffusion de nouveaux services presque exclusivement privés. Cette définition concerne pratiquement toutes les villes d’Amérique latine, grandes et moyennes, et même des villes aussi différentes que São Paulo ou Tegucigalpa.
Enquêter sur les événements qui ont ponctué l’histoire des villes permet de repérer quelles sont les catégories du passé qui éclairent sur celles aujourd’hui en usage et sur les systèmes qui organisent un domaine particulier: en l’occurrence la métropole en Amérique latine.
Quelques paradigmes
En voici quatre en avant dans ce texte qui ont tous fait l’objet de très nombreux travaux.1 1 Il n’est pas possible d’énumérer tous les travaux qui permettent de les présenter
On peut noter en premier lieu la simultanéité dans tous les pays d’Amérique
latine de l’explosion urbaine la plus forte du monde, qualifiée souvent de
spontanée, d’informelle et d’illégale (suivie d’ailleurs de phénomènes
d’implosion urbaine). Quelle interprétation socio-économique donnait-on de ce
processus? Ce fut avant tout une explication sociologique que l’on peut rappeler
dans les termes suivants: on percevait la population “marginale” comme en
attente dans les périphéries de pouvoir conquérir un statut de prolétaire (ou de
salarié) tout en construisant ses territoires spécifiques qui deviendront
rapidement l’expression de la plus forte extension urbaine du monde (le sprawl
d’aujourd’hui). Beaucoup de sociologues ont retracé cette histoire (Duhau, 2012DUHAU, E. (2012). La sociologie urbaine et les métropoles
latino-américaines. SociologieS, Dossier – Actualité de la
sociologie urbaine dans des pays francophones et non anglophones. Disponível em:
http://sociologies.revues.org/4164.
http://sociologies.revues.org/4164...
).
Avec le recul, on peut repérer deux autres éléments d’explication à la construction de ce modèle spatial: l’un renvoie à l’absence de valeur marchande des terrains dans les environs des villes jusqu’à une époque récente (les années 1980) et l’autre serait son corollaire, l’indéfinition prolongée dans le temps du statut de la propriété urbaine. Et l’on voit alors que les divers acteurs qui tirent les ficelles de cette urbanisation sauvage (en dehors de tout code d’urbanisme) ont finalement des comportements très proches les uns des autres dans une ville ou dans l’autre, pour contourner ces obstacles. On verra d’ailleurs plus loin que l’élévation rapide du prix du foncier et le passage au marché, notamment à Mexico et à São Paulo, constituent un des paradigmes essentiel de notre analyse.
Un second point qu’il convient de soulever est le suivant, car il conditionne profondément les nouvelles demandes et formes de gestion des sociétés urbaines en Amérique latine. Ce sont la rapidité de la transition démographique et l’augmentation de l’espérance de vie assorties du modèle théorique qui va avec. Faut-il les relier à celle de l’urbanisation? La relecture des travaux des années 1990 nous y incite. Cette transition a duré vingt-cinq ans (1960-1990), et la différence de comportement entre les zones métropolitaines et les zones rurales était alors plus forte que la différence entre les pays. Dés 1980, selon Maria-Eugenia Cosio (Cosio, 1997), la moyenne du nombre d’enfants par femme était inférieure à 2,5. Ce qui laisse supposer que les immigrés des zones rurales changeaient leur mode de vie aussitôt installés en zone urbaine. Les démographes – dont M.E. Cosio – attribuent à deux causes essentielles cette transition extrêmement rapide qui marque fondamentalement les sociétés urbaines latino-américaines. Ils font d’abord référence à l’importance des politiques médicales en Amérique latine depuis les années 1930, puis au changement d’attitude des familles pauvres urbaines vis-à-vis de la fécondité. En effet, la multiplication des enfants par famille ne serait plus depuis les années 1980, une sécurité pour la survie de la famille mais au contraire les difficultés économiques de ces années-là, auraient conduit les femmes, pour y faire face, à une utilisation massive des contraceptifs, à leur disposition dans des conditions d’accès facile, surtout en ville.
Ce changement ajoute Cosio, a été partout de pair avec une politique de soutien à la famille urbaine imaginée au Mexique mais qui a inspiré dans tout le sous-continent selon des modalités assez proches et pour l’application desquelles la responsabilité des femmes est valorisée. En même temps l’espérance de vie a augmenté à un rythme tout aussi rapide faisant apparaître une société urbaine en charge de plusieurs générations.
On se trouve donc dans une période où les jeunes (moins de trente ans) sont encore nombreux et les vieux (plus de 60 ans) aujourd’hui très présents. Cette structure démographique suppose à la fois un changement par rapport au travail, une grande partie de la population étant inactive et des retraites, en dehors de la fonction publique, faibles, non prévues ou inexistantes. La traditionnelle prise en charge des personnes âgées par la famille est aujourd’hui ébranlée et ces dernières constituent une demande nouvelle, tout comme les jeunes (étudiants, célibataires), à l’adresse des pouvoirs locaux notamment en termes d’offre de logements. Quel est en effet maintenant le statut de trois générations vis-à-vis du crédit ?
En d’autres termes, les conditions démographiques d’aujourd’hui ne contredisent pas les présupposés théoriques considérés comme universels, mais les placent dans une perspective conjoncturelle avec les écarts et les divergences dans leurs effets que cela suppose.
Il est un troisième paradigme, récurrent lorsqu’on évoque les villes de l’Amérique latine, c’est celui de l’impact des inégalités sociales extrêmes depuis des décennies, qui ont conduit les bureaux d’études de marché à découper la société en cinq grandes “classes”, A,B,C,D,E qui n’ont plus rien à voir avec les schémas marxistes du passé. Elles fondent aujourd’hui les politiques urbaines, notamment celle du logement. Stéréotypées par des agences qui agissent au plan national ou international, elles se sont substituées aux catégories anciennes de salariés, de “marginaux”, et même à celles apparues plus tard, de pauvres et de riches. Par rapport à ces anciennes catégories, elles donnent une image aseptisée de la société transformée en un agglomérat de consommateurs, en synthétisant dans une lettre la diversité des statuts professionnels, des métiers, des activités et des conditions sociales. De ce fait, elles semblent acceptées comme des “données fixes”, impossibles à questionner. “J’appartiens à la classe “D”, précise tel employé du commerce; cela devrait suffire pour expliquer à son interlocuteur son mode de vie et plus encore sa conduite. Mais ces catégories sont en même temps devenues un instrument technique d’urbanisme communs aux architectes, aux promoteurs et aux gestionnaires puisque le recours à leur existence conditionne fortement les interventions sur l’espace urbain en cours de construction ou de transformation, tant du point de vue des infrastructures que des services et du logement. Elles sont le révélateur principal de l’avenir possible d’un quartier puisqu’elles traduisent la capacité de ses habitants à payer des impôts mais plus encore à recevoir un crédit.2 2 On peut se demander alors, pourquoi les métropoles d’Amérique latine n’ont pas connu la crise comme Cleveland ou Madrid ; peut-être est-ce du à la prudence des promoteurs et des banquiers, pas encore persuadés que la majorité de la population urbaine était d’ores et déjà devenue “classe moyenne” ou plutôt D + ou C. Ce qui renvoie à une définition d’un modèle de ville “latino-américaine” aujourd’hui “financiarisée”, supporté par un prix du foncier urbain en augmentation extrêmement rapide. En même temps, ces augmentations des prix obligent les différentes catégories de la population à modifier leurs stratégies traditionnelles d’accès au logement comme l’occupation, et à entrer dans la bataille du marché. Ainsi, les entrepreneurs, tout comme les organisations populaires, certes munis d’”armes” différentes, sont contraints d’entrer dans ce que certains appellent la “chasse pour les espaces”.3 3 C’est par cette métaphore qu’un des leaders de l’União dos Movimentos de São Paulo résume la tactique d’entrée des organisations populaires dans le marché du foncier .
Il y a deux types de réponses à ce dilemme de la part des populations les plus modestes qui conditionnent la reproduction du modèle spatial centre/périphérie qu’on plaquait traditionnellement sur les espaces métropolitains latino/américains, nuancée par les avis d’auteurs qui parlent de fragmentation plutôt que de ségrégation. C’est donc le modèle “multicentralités/périphéries”; on s’y tiendra ici. Les deux types de réponse, même s’ils s’expriment différemment, sont présents dans nombre de grandes villes d’Amérique latine. L’un est l’acceptation de la relégation résidentielle loin des centres-villes qui sont pourtant les espaces les plus pourvoyeurs d’activités à tout niveau de qualification, d’activités précaires, d’activités de nuit enfin. Et cela, au risque d’accumuler les heures dans tous les genres de transport publics ou privés et de devoir inventer de nouveaux modes de vie. La deuxième, c’est l’invention de formes de pression sur les pouvoirs locaux pour que soit facilité l’accès au logement par un crédit adéquat ou pour qu’ils reconnaissent le droit des gens à rester où ils sont. Ces formes de pression peuvent s’exercer dans la rue en même temps qu’au sein des institutions de participation. Théoriquement mises en place presque partout en Amérique latine selon un schéma inspiré des expériences de gouvernement municipal du PT brésilien, le modèle de la ville latino-américaine “participative” a fait le tour de la planète et inspiré tant les pouvoirs locaux que les organisations internationales lorsqu’elles énumèrent les conditions de la démocratie ou de la sustainable city.
Le premier type de réponse, l’acceptation de la relégation renvoie à l’extrême difficulté qu’éprouvent en effet les pouvoirs publics à donner une cohérence aux politiques de transport ou à réguler celles actuellement en vigueur. Il s’agit sans doute de l’un des traits marquants du modèle latino-américain depuis de longues années et l’un des plus explosifs de la dernière décennie. Or, on peut noter que le problème des transports est absent du discours des maires pourtant souvent de gauche ou tout du moins ouverts à la participation, alors qu’il occupe une place constante dans celui de la société urbaine toutes classes confondues. Les institutions municipales semblent d’ailleurs prises en étau entre l’inextricable confusion qui règne dans le secteur privé ancien et dans les services plus récemment privatisés et un secteur public parfois présent mais débordé par l’urgence.
Ville chaotique ou ville néolibérale ?
Tandis que jusqu’aux années 1960, les architectes détenaient un quasi monopole de la réflexion sur l’urbanisme et les villes, la croissance folle de ces dernières, tant en extension qu’en population, contribua à leur confisquer. Apparue d’abord comme une vitrine de la modernisation – une vision que l’époque autoritaire s’était efforcée de rendre officielle pendant deux décennies – cette croissance s’est transformée peu à peu en crise, en cauchemar même, qui atteignit son apogée dans les années 1980. Une crise cependant si difficile à résorber que les villes d’Amérique latine font encore partie, dans les années 2000, de cette Planet of Slums, un titre choc qui transforma alors le livre de Mike Davis en best-seller. D’ailleurs les statistiques internationales, associant toujours implicitement pauvreté et violence, présentent toujours quelques-unes des villes d’Amérique latine comme les plus violentes du monde.
Mais il s’agit d’un raccourci trompeur. La question mérite d’être posée différemment. Les paradigmes que l’on a soulevés dans la première partie de ce texte, qui sont l’écume du néo-libéralisme, mêlée à des histoires diverses, ne manquent pas d’interroger sur la continuité d’expériences communes dans tout le continent et dans le temps , parfois avec quelques années ou une décennie de décalage.
Au niveau local, la coïncidence principale réside dans une certaine similitude du discours politique tenu par des pouvoirs locaux dont la fibre sociale a souvent précédé celle des gouvernements nationaux, mais qui vivent déjà des alternances politiques. Ils sont le reflet d’attitudes de classes moyennes qui ne sont plus imprégnées par l’analyse radicale des intellectuels organiques des années 1990. Ce sont des pouvoirs locaux qui cherchent dans la panoplie des mesures sociales/techniques proposées par les forums internationaux, des inspirations urbanistiques et sociales. Ils reconnaissent la similitude des problèmes qui se posent dans toute l’Amérique latine. Ils sont d’ailleurs souvent perçus comme les seuls porteurs d’un discours aujourd’hui de gauche dans le monde et critique d’un néo-libéralisme appliqué à la gestion du territoire urbain.
Cependant le coût social des doctrines néo-libérales qui se sont répandues à la suite du consensus de Washington, adoptées par les successeurs des gouvernements autoritaires succédant aux dictatures, semblent avoir laissé s’étendre partout une certaine défiance vis-à-vis de la classe politique locale ou même nationale.
Du côté de la société urbaine, le contenu du terme “informalité” dans le travail et les activités a changé de sens. Il désigne aujourd’hui un phénomène qui s’étend de la précarité à la transgression (Telles, Giglia et Azaïs, 2012) et ce n’est pas seulement l’éventuelle “désindustrialisation précoce” des pays selon l’expression déjà adoptée par les économistes, et par conséquent des villes où les formes de salariat traditionnel stagnent, qui en est la cause. On pourrait même presque dire qu’en se rapprochant des caractéristiques des emplois informels et en transgressant de façon complexe le droit du travail, les emplois formels s’ “informalisent” (Salama, 2013SALAMA, P. (2012). Les économies émergentes latino-américaines, entre cigales et fourmis. Paris, Armand Colin.).
Cela veut-il dire pour autant que ce modèle urbain de la période actuelle pourrait encore s’expliquer au moyen de deux thèses qui furent très répandues dans les années 1960-1980 et qui, l’une et l’autre, faisaient de l’Etat l’acteur principal du débat parce qu’il ne jouait pas son rôle. L’une de celle-ci, celle de Manuel Castells, très diffusée alors en Amérique latine, voyait l’Etat avant tout comme l’expression et l’obligé des intérêts de classe, une thèse dépassée aujourd’hui par lui-même d’ailleurs. Celle de O’Donnell expliquait les expériences autoritaires de l’époque comme une alternative à l’incapacité des gouvernants d’approfondir ce qui pouvait dynamiser le processus d’industrialisation, une fois l’ISI sur les rails. Elle est également dépassée même si l’on cherche encore à refonder l’Etat et la nation. C’est alors dans l’analyse comparée des expériences urbaines qu’il faut continuer de chercher un modèle latino-américain qui se transforme sans cesse, en se situant à une échelle et à un degré de précision qui donne du sens à la figure abstraite d’un éventuel modèle.
Conclusion
Le résumé d’une expérience de recherche menée à São Paulo et à Mexico servira de conclusion (Rivière d’Arc, 2014RIVIÈRE D’ARC, H. (2014). “São Paulo et Mexico, ‘chasse aux espaces’ ou nouvelle dictature du foncier urbain”. In: AZAÏS, C. e LEHALLEUR, M. P. (dirs.). La gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine. Berna/Bruxelas, Peter Lang (no prelo.), Menna Barreto, 2014MENNA BARRETO, H. e MIGNAQUI, I. (2014). “Interventions publiques, financement et production du logement, comparaison São Paulo et Buenos Aires”. In: AZAÏS, C. e LEHALLEUR, M. P. La gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine. Berna/Bruxelas, Peter Lang (no prelo.)). Elle portait sur une comparaison entre les différentes formes d’accès au logement dans un contexte de forte montée des prix du foncier urbain. Elle s’appuyait sur un constat commun aux deux villes, celui d’une extension urbaine extrêmement forte (sprawl ou espalhamento) malgré le ralentissement de la croissance de la population. Ce constat révélait un des besoins le plus impératif de la société : le logement. La question pour les municipalités qui composent les aires métropolitaines est donc celle-ci: comment gérer et/ou interrompre cette extension tout en répondant aux besoins résidentiels les plus urgents sans qu’ils soient trop dévoreurs d’espaces.
A Mexico, dans les années 2000, sous les gouvernements d’Andres Manuel Lopez Obrador et de ses successeurs, pour tenter de réguler l’extension spatiale dans un espace administratif donné, le DF, fut mis au point un programme qui n’a pas duré longtemps mais qui a eu des conséquences immédiates et s’est attiré les foudres de nombreux acteurs, le Bando 2. Ce programme prétendait interdire la promotion de nouveaux ensembles résidentiels dans la deuxième couronne par rapport au centre historique, c'est-à-dire dans le Bando 2, afin de concentrer les investissements et de donner une impulsion concrète à la requalification du centre historique dégradé et même dépeuplé. Mais quels étaient les moyens de pression du gouvernement municipal sur les entreprises de construction, qui pour leur part, ont bénéficié d’un processus de transfert de la promotion du logement au secteur privé, pour qu’elles investissent exclusivement dans le centre ville où les prix du foncier amorçaient une croissance considérable ? Bien faibles. Les conséquences de ce programme furent donc l’émigration des opérations de logement au-délà du Bando 2, dans des municipes de l’état de Mexico, ravis de concéder des terrains très bon marché à des entreprises supposées prendre en charge les infrastructures et susceptibles de devenir des contribuables.
Ce résultat assez proche, semble-t-il, de la situation de Madrid avant la crise,4 4 Même si on n’a pas parlé de bulle à Mexico. a par ailleurs largement contribué à l’extension urbaine, et à la construction de lotissements très lointains des zones d’activités du DF. Bref une situation qui, du point de vue social et du récit de leur vie quotidienne par les habitants, ressemble à celle de maintes villes d’Amérique latine et de São Paulo parmi elles. On peut retenir qu’un des points clef du débat aujourd’hui est bien la trop grande distance au lieu et aux possibilités de travail.
A l’inverse, à São Paulo la municipalité ne s’est pas prononcé de façon autoritaire mais a plutôt tenté de promouvoir des investissements dans l’espace urbanisé. Contrairement à ce qui s’est passé dans la Zone Métropolitaine de Mexico, la “bulle immobilière” a touché le haut de gamme et a atteint un sommet au début des années 2000. Mais en 2007, cette activité a connu une chute assez brutale. Les entreprises qui travaillaient pour le haut de gamme se sont alors tourné vers un autre marché, celui des classes moyennes C et D selon un modèle résidentiel standardisé et peu coûteux. La gamme des programmes proposés par le gouvernement central, par le biais de la Caixa Econômica, leur a permis cette reconversion. Elles se saisissent par ailleurs des espaces laissés disponibles par la démolition des zones industrielles. Et, pour pratiquer leur reconversion, elles ont recours au pragmatisme suivant: construire selon les opportunités soit dans la zone métropolitaine, soit sur le territoire municipal, tout en laissant par ailleurs à la municipalité le soin de résoudre la question du logement des “moins de cinq salaires minimum”, soit les D, c’est-à-dire des investissements à fond perdu.
Or, malgré ces différences et l’intérêt que les entrepreneurs paulistes ont porté aux débuts de l’expérience mexicaine (Construção modelo popular, 2007), on se trouve aujourd’hui ici et là face à un prix du foncier qui monte rapidement même si c’est de façon très inégale selon les espaces. Dans le DF, c’est parce qu’il n’y a pas beaucoup d’offre; dans le municipe de Sao Paulo, parce que les espaces éventuellement disponibles et minutieusement pourchassés par les uns et par les autres, sont presque invariablement requalifiés pour le logement d’une population capable de payer.
Face à cette financiarisation des espaces urbains, stratégies et actions de la part des habitants ou des prétendants à la ville, ont changé tant à Mexico qu’à São Paulo. L’occupation ou l’invasion comme des savoir-faire traditionnels qui ont caractérisé plus d’un siècle d’urbanisation tant ici que là, ne sont plus la forme d’action dominante. A Mexico, la revendication dominante et le thème de mobilisation le plus fort sont bien celui de l’accès à un crédit approprié à la situation du débiteur. Une autre forme, compatible avec la première, c’est l’adhésion à une association dont le leader se charge de porter la demande auprès de l’INVI (Instituto Nacional de la Vivienda), ou directement auprès de la mairie cour-circuitant ainsi la participation, même si la pratique de cette dernière est affichée par le maire de Mexico qui prétend s’inspirer du Estatuto da Cidade Brasileira dans le discours qu’il a prononcé lors de la signature de La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a Ciudad, le 13 juin 2010.
A São Paulo, O Movimento a choisi trois modalités d’action.5 5 Entretien de l’auteur avec les leaders du Movimento (2009, 2010). Il participe par ses membres élus au Conseil Municipal d’Habitation avec ses alliés des ONG, mais le budget destiné au logement examiné par ce conseil est extrêmement faible au regard des besoins. Il recherche par ailleurs des terrains qui pourraient être constructibles ou réhabilités pour des raisons diverses6 6 En général, d’anciens terrains industriels et/ou des terrains abandonnés. qu’il occupe symboliquement tout en faisant pression sur la mairie pour qu’elle les préempte ou les achète à bas prix.
Des stratégies différentes donc, mais des points communs: la financiarisation de la ville a fait basculer les stratégies traditionnelles dont le corollaire était le statut flou de la propriété vers des actions tout à fait consciemment intégrées dans le marché. Il y a donc là encore simultanéité de changements marquants dans les deux villes. Ici et là, par ailleurs, on remarque l’importance du rôle accordé aux corporations et aux milieux professionnels dans le débat. Ce qui permet d’émettre la remarque suivante: la prise en compte des inégalités sociales extrêmes comme élément structurant des projets d’urbanisme comme “données sociales fixes”, conduit les professionnels ici et là, à la réalisation pratique de modèles architecturaux très proches. L’application de ces modèles traduit une même combinaison de données, le coût de la construction, le plus bas possible pour contrebalancer le prix du foncier; et il se dégage finalement une sorte de consensus autour d’un modèle unique de petites maisons et appartements (autour de 40 m2).7 7 Anecdote: le voyage des entrepreneurs de São Paulo dans l’état de Mexico en 2009, pour comprendre comment il était possible de construire d’aussi grands lotissements de maisons si bon marché (Ecatepec, Cuautitlan).
Un modèle spatial donc, dont la grille de lecture sociologique et géographique est très proche. Ainsi s’est construite la ville latino-américaine néo-libérale. Elle est pourtant – déjà – aujourd’hui dans une nouvelle phase. Celle d’une prise de conscience sur le plan politique et engagé de certains méfaits de ce néo-libéralisme: le choix unilatéral de la priorité donnée à la voiture particulière boosté par le crédit facile, alors qu’en même temps on privatisait les services; une éthique politique qui semble souvent se satisfaire de la seule réussite de ses élites, malgré une réduction générale des inégalités et de la pauvreté dans la plupart des pays.8 8 Affirmation tenue sous réserve. En revanche, les réunions et les forums fréquentés par les membres des réseaux professionnels latino-américains (de véritables virtual communities latino-américaines), se tiennent de façon presque ininterrompue sur la façon de traiter la ville. Et cela, à un moment où le rôle de l’Etat est à nouveau posé au cœur des scènes latino-américaines et où certaines politiques urbaines, menées par les pouvoirs locaux plus tôt là qu’autre part – à Bogota ou Medellin par exemple – apparaissent déjà comme l’anticipation d’un modèle “actif” et “actant” pour les villes du continent.
Referências
- AZAÏS, C. e STECK, J. F. (2011). Les territoires de l’informel. Espaces et Sociétés, n. 143.
- CASTELLS, M. (1972). La question urbaine Paris, Maspero.
- COSIO ZAVALA, M. E. (1997). Changements démographiques en Amérique latine. Cahiers des Amériques latines, n. 22.
- DAVIS, M. (2006). Planet of Slums Londres/Nova York: Verso.
- DUHAU, E. (2012). La sociologie urbaine et les métropoles latino-américaines. SociologieS, Dossier – Actualité de la sociologie urbaine dans des pays francophones et non anglophones. Disponível em: http://sociologies.revues.org/4164.
» http://sociologies.revues.org/4164 - DUHAU, E. e DUHAU A. G. (2008). Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli. Mexico, Siglo XXI.
- MENNA BARRETO, H. e MIGNAQUI, I. (2014). “Interventions publiques, financement et production du logement, comparaison São Paulo et Buenos Aires”. In: AZAÏS, C. e LEHALLEUR, M. P. La gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine Berna/Bruxelas, Peter Lang (no prelo.)
- O’DONNELL, G. (1979). “Tensions in the bureaucratic authoritarian state and the question of democracy”. In: COLLIER, D. (ed.). The new authoritarism in Latin America Princeton-NJ, Princeton University Press.
- RIVIERE D’ARC, H. e SCHNEIER, G. (1993). “De Caracas à Rio et Buenos Aires: un siècle d’aspiration à la modernité urbaine”. In: RIVIERE D’ARC, H. (dir.). L’Amérique du Sud au XIXe et XXe siècles, héritages et territoires Paris, Armand Colin.
- RIVIÈRE D’ARC, H. (2012). “Savoir-faire no acesso ilegal/informal à habitação na cidade do México e em São Paulo”. In : AZAÏS, C.; KESSLER, G. e TELLES, V. da S. Ilegalismos, cidade e política Belo Horizonte, Traço.
- RIVIÈRE D’ARC, H. (2014). “São Paulo et Mexico, ‘chasse aux espaces’ ou nouvelle dictature du foncier urbain”. In: AZAÏS, C. e LEHALLEUR, M. P. (dirs.). La gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine Berna/Bruxelas, Peter Lang (no prelo.)
- SALAMA, P. (2012). Les économies émergentes latino-américaines, entre cigales et fourmis Paris, Armand Colin.
- SASSEN, S. (1991). The Global Cities: London, Tokyo, New York Princeton-NJ, Princeton University Press.
- TELLES, V. da S. (2012). “Jogos de poder nas dobras do legal e do ilegal; anotações de um percurso de pesquisa”. In: AZAÏS, C.; KESSLER, G. e TELLES, V. da S. Ilegalismos, cidade e política Belo Horizonte, Traço.
Notas
-
1
Il n’est pas possible d’énumérer tous les travaux qui permettent de les présenter
-
2
On peut se demander alors, pourquoi les métropoles d’Amérique latine n’ont pas connu la crise comme Cleveland ou Madrid ; peut-être est-ce du à la prudence des promoteurs et des banquiers, pas encore persuadés que la majorité de la population urbaine était d’ores et déjà devenue “classe moyenne” ou plutôt D + ou C.
-
3
C’est par cette métaphore qu’un des leaders de l’União dos Movimentos de São Paulo résume la tactique d’entrée des organisations populaires dans le marché du foncier .
-
4
Même si on n’a pas parlé de bulle à Mexico.
-
5
Entretien de l’auteur avec les leaders du Movimento (2009, 2010).
-
6
En général, d’anciens terrains industriels et/ou des terrains abandonnés.
-
7
Anecdote: le voyage des entrepreneurs de São Paulo dans l’état de Mexico en 2009, pour comprendre comment il était possible de construire d’aussi grands lotissements de maisons si bon marché (Ecatepec, Cuautitlan).
-
8
Affirmation tenue sous réserve.
Publication Dates
-
Publication in this collection
June 2014
History
-
Received
10 Nov 2013 -
Accepted
15 Dec 2013